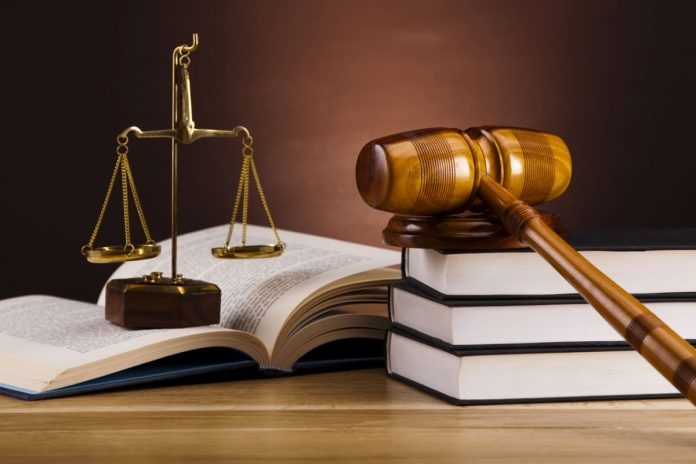Thème
Dévolution successorale :La liberté du testateur ou du donateur dans la dévolution successorale
Pb :Le testateur ou donateur dispose t'il d'une entière liberté pour assurer la transmission de ses biens ?
La désignation des héritiers, prévue par la loi ne s'impose pas de façon absolue au de Cujus, Car il peut en décider autrement par donation ou par testament. Le de cujus peut décider du sort de sa succession de plusieurs façons; en disposer à titre onéreux de son vivant (vendre.....)ou à titre gratuit par testament ou par donation (Avec le contrat à titre onéreux, chacun reçoit un avantage qui est la contre partie de celui qu'elle procure à l'autre. Dans le contrat à titre gratuit, le patrimoine du bénéficiaire s'enrichit, tandis que celui du gratifiant s'appauvrit sans qu'il y ait un manque à gagner. Le disposant se dépouille au profit du gratifié). La loi permet à toute personne d’organiser elle-même la dévolution de ses biens par le biais des libéralités. Ces libéralités modifient la dévolution légale. Il s'agit de la manifestation ordinaire du pouvoir de la volonté (par convention). Toutefois, ce pouvoir de la volonté connaît une atténuation, c est l’ordre public successoral (I) qui interdit à un disposant de porter atteinte à la réserve héréditaire. pour assurer la dévolution de ses biens. Et dès qu'il y a libéralité, la succession se divise en 2 parts : la réserve et la quotité disponible.
En effet, le testateur ou le donateur ne dispose pas d'une entière liberté. ne peut alors valablement disposer à titre gratuit que d'une partie des biens, la quotité disponible. La réserve revient aux proches parents qualifiés d'héritiers réservataires et
I- La manifestation de la liberté successorale du donateur ou testateur dans la dévolution de ses biens
La loi permet à toute personne d’organiser elle-même la dévolution de ses biens par le biais des libéralités. Ces libéralités modifient la dévolution légale. Il s'agit de la manifestation ordinaire du pouvoir de la volonté (par convention) qui se traduit soit par la donation(A); soit par le testament (B) et I’ institution contractuelle. Seules le testament et la donation seront examines. En effet, une personne peut procéder à une transmission gratuite en amendant celle que la loi organise à sa mort
A- La manifestation de la liberté dans la donation
L’article 894 c. civ. définit la donation comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». Elle peut être faite entre vifs ou à titre de mort. Lorsqu'elle est faite en très vifs, le donateur transfert tout ou partie de son patrimoine en faveur d'une autre personne. Cela peut aussi avoir lieu du vivant du donateur, mais, pour n'être exécutée qu'après son décès. En effet, relativement au principe du consensualisme en matière contractuelle, la volonté de ce dernier peut arborer une certaine liberté, si non, une liberté certaine lorsqu'il décide de disposer de ses biens de « la manière la plus absolue ». Ainsi, le droit de disposer se trouve alors absolu, ainsi que dans une certaine mesure, le choix de son bénéficiaire.
B- Manifestation de la liberté en matière testamentaire
L’article 895 c.civ définit le testament comme étant « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps qu’il n existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer ». c'est donc un acte juridique unilatéral à cause de mort dont les effets ne se réalisent qu’au décès du testateur, et qui est essentiellement révocable. C’est aussi un acte solennel. Lorsqu’il y a testament, la loi cède sa place a la volonté du testateur pour assurer la dévolution de tout ou partie de la succession. Qu'il s'agisse d'un testament olographe, authentique ou même mystique, le choix du bénéficiaire dépend entièrement de la volonté libre et éclairée du testateur. Ce qui invite à penser à une certaine liberté de disposer et de transmettre son patrimoine aux personnes dont on estime avoir le plus confiance. Ainsi, cette désignation du bénéficiaire encore appelé légataire, subodore une existence certaine et nette, qu'elle soit directe ou indirecte. Il peut s'agir d'un parent, d'un collatéral ou même de toute personne tiers suivant sa dernière volonté écrite.
Dans le même sens d'idée, le testateur jouis d'une véritable liberté lorsqu'il détermine l'ensemble de ses biens qu'il voudrait transmettre après sa mort. Il peut s'agir de tout ou partie de son patrimoine selon l'expression de sa volonté
Tout cela laisse entrevoir la liberté et le pouvoir qu’a le testateur dans la dévolution successorale de son patrimoine. Mais toutefois, si cette assertion tant à trouver refuge dans le régime juridique même des libéralités, cela va sans dire que ce principe reste absolu au regard de la considération notoire que la loi attribue à la famille du défunt, du fait de sa vulnérabilité après le décès de ce dernier.
II- Limites à la liberté successorale
A-limites conventionnelles
La donation est toujours faite à titre particulier, en ce sens quelle ne porte que sur un ou plusieurs biens déterminés, et jamais sur la totalité ou une quote-part du patrimoine. Par ailleurs, la donation est irrévocable, le donateur se dépouille « irrévocablement», Cette irrévocabilité résulte de l’ article 1134 c. civ. Qui lait des contrats la loi des parties. En effet, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites (art 11:34 al. 1), elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (al21). Par Conséquent, le donateur ne peut reprendre ce qu’il a donné. La donation obéit au respect des conditions de fond (capacité, consentement, objet, cause et charge) et des conditions de forme ( exigence d'un acte notarié, ) et produit des effets. Mais son originalité se manifeste par rapport à une règle importante: l'irrévocabilité. (L'article 1134 al. 1er ). I ‘alinéa 2 le renforce en disposant que les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel des parties Contractantes ou pour les cas que la loi autorise. Mais cette irrévocabilité n' est pas absolue, car une partie peut unilatéralement mettre fin à un contrat par sa seule volonté. Dans les contrats successifs, le droit de résiliation unilatérale est souvent stipulé. A cela la loi ajoute la nullité des obligations contractées sous condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Par contre, l'irrévocabilité spéciale est reconnue dans les donations par l'adage « donner et retenir ne vaut », Elle est consacrée par l'article 894 C.civ. Aussi, aux termes de l'article 944 C. civ. « toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle », Il en est de même des donations conclus sous condition mixte, celle-ci dépendant à la fois de I ‘auteur de l'acte et de la volonté d'un tiers (art. 1171). Pour la donation de biens à venir, l'article 943 dispose que « la donation entre vifs ne pourra comprendre que des biens présents du donateur ; si elle comprend les biens à venir, elle sera nulle à cet égard ».
Les actes qui ne respectent pas le principe de I ‘irrévocabilité sont sanctionnés par la nullité absolue.
A- Limite légale : la réserve héréditaire
La réserve est définie comme la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer a titre gratuit, et que se trouve ainsi réservée a ses héritiers qualifiés de réservataires. le défunt ne peut outrepasser cette quotité disponible et entamer la réserve. Elle est un instrument de conservation des biens dans la famille et est l’ expression d un devoir d’assistance économique qui existe entre parents.
Par ailleurs, elle assure une égalité minimum entre les enfants lorsque la dévolution ab intestat s’opère selon le principe d égalité, car c’est seulement dans la limite de la quotité.
Les réservataires ont le droit, à son décès, de demander la réduction des libéralités excessives. Ainsi, Elle limite la plénitude de sa propriété et sa liberté contractuelle. Son fondement conduit a la protection des proches parents (ascendants et descendants), contribue ainsi à la cohésion du groupe familial. Les bénéficiaires de la réserve héréditaire sont entre autre : les descendants
(art. 913 c. civ.) et les ascendants (art. 914 c. civ.).
Elle n’est donc reconnue qu' aux parents en ligne directe, Peu importe le degré de parenté, ni la nature de la parenté: légitime, naturelle et sont exclus de la qualité de réservataires, les collatéraux et le conjoint survivant.
Le taux de la réserve de chacun peut être fixé à une fraction de sa part héréditaire. En considérant l’ ensemble des biens, elle peut aussi être fixée à une quote-part de Cet ensemble, On est alors conduit, Suivant les deux procédés, à distinguer la réserve globale et les parts de la réserve en déterminant positivement la quotité disponible et en déduisant la réserve par le taux de la quotité disponible. La réserve varie en fonction de trois paramètres: la qualité des héritiers (ascendants, descendants), leur nombre et la qualité du gratifie (conjoint survivant ou autre). Ils agit d examiner le mécanisme par lequel les réservataires peuvent faire rétablir le taux légal de la réserve lorsque le de cujus a fait des libéralités outrepassant la quotité disponible.
A cet effet, il faut d’abord déterminer les dispositions pouvant porter atteinte a la réserve avant d’analyser les modalités de leur sanction. En effet, la réserve ne saurait être grevée ni d’une clause d’inaliénabilité, ni d’une substitution, ni d’une charge. Si tel est le cas, elle se verra réduite, ainsi que la clause qui l'accompagne. La réduction doit être demandée et elle ne peut l'être que par un héritier réservataire.
Par TJOMB Georges Emmanuel, juriste consultant